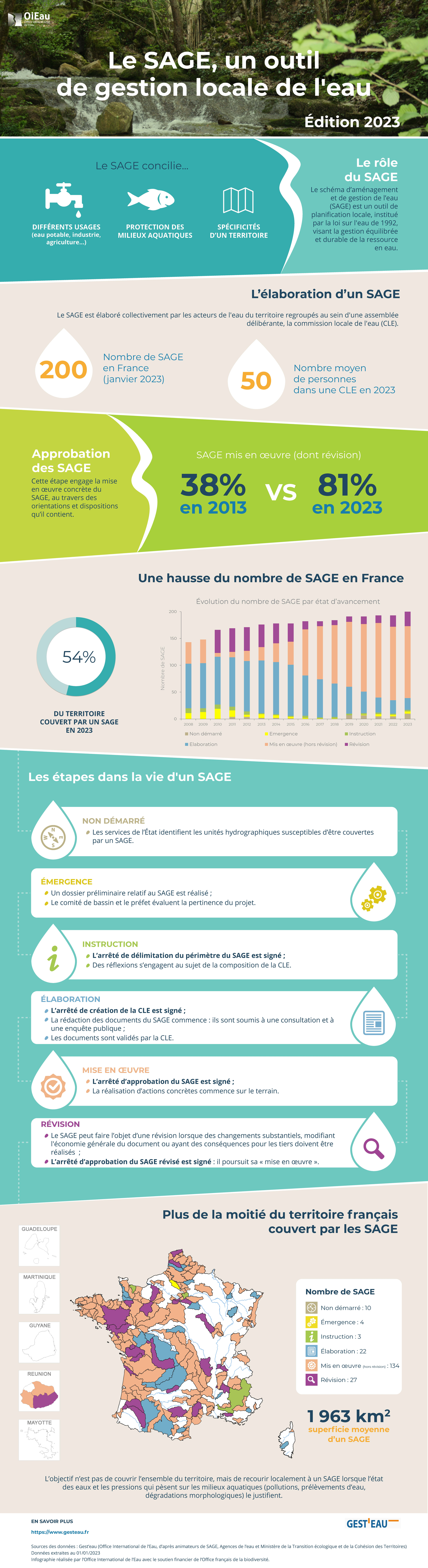Le SAGE a un rôle central pour mettre en œuvre la « politique locale » de l’eau. Son objectif est de trouver un équilibre durable entre les besoins des activités socio-économiques du territoire et la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques. C’est au SAGE notamment que revient la mission de préciser, en concertation avec les acteurs du bassin Allier aval, les moyens permettant la restauration et le maintien de la fonctionnalité des nappes d’eau souterraines, des cours d’eau et de leurs milieux associés.
Le SAGE est un outil participatif et réglementaire au service d’une gestion intégrée de l’eau. Il traduit localement les grands objectifs environnementaux tout en s’adaptant aux réalités et besoins des territoires. Sa mise en œuvre est essentielle pour concilier développement économique, préservation de l’environnement et bien-être des populations.
Qu’est-ce qu’un SAGE ?
Le SAGE est un document de planification conçu pour répondre aux enjeux locaux de gestion de l’eau, tout en respectant les grandes orientations fixées au niveau national et européen. Il sert de cadre stratégique pour :
- Protéger les ressources en eau (cours d’eau, nappes souterraines, zones humides, etc.).
- Garantir un partage équilibré de la ressource entre les différents usages (eau potable, agriculture, industrie, loisirs).
- Préserver les écosystèmes aquatiques et leur biodiversité.
Le SAGE repose sur deux parties principales :
- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) : fixe les orientations générales et les objectifs à atteindre.
- Le Règlement : comprend des règles opposables aux tiers pour encadrer certaines activités.
Comment fonctionne un SAGE ?
- Élaboration : Le SAGE est conçu par une Commission Locale de l’Eau (CLE), composée d’élus, d’usagers (associations, agriculteurs, industriels, etc.) et de représentants de l’État.
- Validation : Après consultation publique, le SAGE est approuvé par le préfet.
- Mise en œuvre : Les acteurs locaux (collectivités, entreprises, agriculteurs) doivent se conformer aux orientations et au règlement du SAGE. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être appliquées.
Les bénéfices d’un SAGE
- Adaptabilité locale : il prend en compte les spécificités du bassin versant concerné.
- Concertation : il implique tous les acteurs concernés pour garantir des décisions partagées.
- Protection de l’environnement : il contribue à la préservation des milieux aquatiques, essentiels pour la biodiversité et les services écosystémiques.
Quelques exemples
Un SAGE peut, par exemple :
- Réguler les prélèvements d’eau pour éviter la surexploitation des nappes phréatiques.
- Encadrer les pratiques agricoles pour limiter les pollutions diffuses par les nitrates ou pesticides.
- Protéger les zones humides, reconnues pour leur rôle dans la régulation des crues et la qualité de l’eau.
Pour aller plus loin consulter la page web du site gesteau.fr dédiée au SAGE : https://www.gesteau.fr/presentation/sage
Le cadre réglementaire
Le SAGE trouve sa base légale dans plusieurs textes :
- Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000 : adoptée par l’Union européenne, elle impose à ses États membres d’atteindre le « bon état écologique » des eaux. Cette directive fixe le cadre général dans lequel s’inscrit le SAGE.
- Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 : en France, cette loi renforce les dispositifs locaux de gestion de l’eau et donne une portée contraignante au SAGE.
- Code de l’environnement (articles L. 212-1 et suivants) : encadre l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre des SAGE.
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : document stratégique élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques, il guide l’élaboration des SAGE.